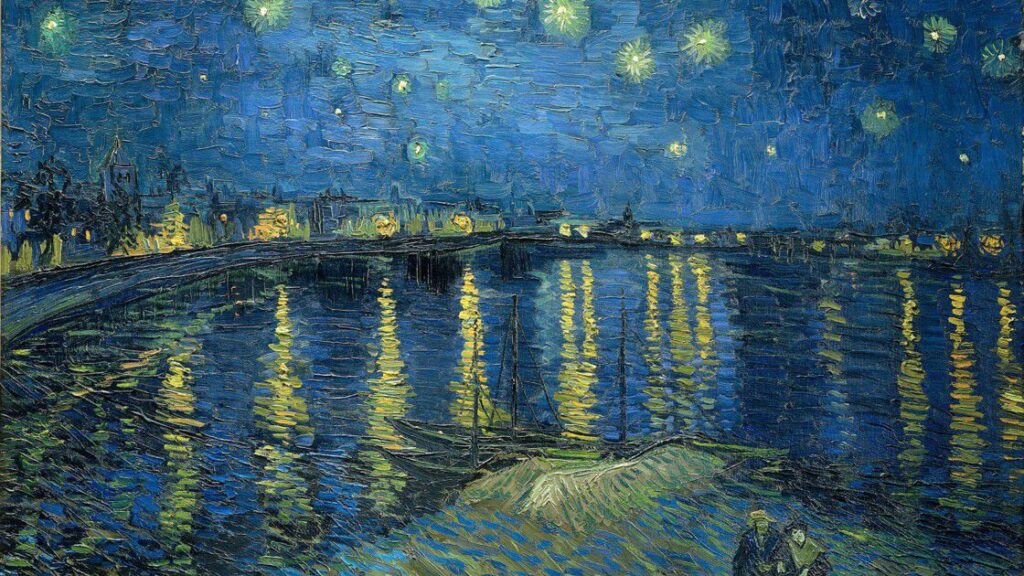Dans le cadre du programme de philosophie du concours A/L et LSH 2025, nous te proposons une distinction conceptuelle des notions de déontologisme et de conséquentialisme.
Définitions
Dans l’arène des grandes doctrines morales, deux géants s’affrontent : le déontologisme et le conséquentialisme. Le premier, attaché aux principes, s’oppose au second, attaché aux résultats.
Cette opposition, loin d’être purement théorique, irrigue nos choix quotidiens, nos débats politiques et économiques, et jusqu’au management et à la stratégie d’entreprise. Comprendre ces deux approches, c’est se doter d’un prisme analytique redoutable pour briller en dissertation.
Déontologisme : la morale des principes
Le déontologisme, incarné par Kant, proclame que certaines actions sont moralement obligatoires, indépendamment de leurs conséquences. Autrement dit : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. »
Dans cette perspective, il n’est pas acceptable de mentir, même pour sauver une vie, car le mensonge porte en lui la négation d’un principe universalisable.
Cette éthique de la conviction séduit par sa clarté : pas de compromis, pas de calcul. Mais est-elle viable dans un monde complexe ? Le dirigeant peut-il ignorer les répercussions de ses décisions au nom d’un principe abstrait ?
Conséquentialisme : la morale des résultats
Face à la rigueur déontologique, le conséquentialisme, dont l’utilitarisme de Bentham et Mill est la forme la plus célèbre, se veut pragmatique : « La meilleure action est celle qui maximise le bonheur du plus grand nombre. » Ici, le bien se mesure aux conséquences. Le mensonge devient acceptable s’il sauve des vies.
Cette approche triomphe dans le champ économique, où le calcul coûts/bénéfices prévaut. Mais ne conduit-elle pas à justifier l’injustifiable si le résultat semble bénéfique ? Peut-on sacrifier un innocent pour le bien commun ?
Un débat stratégique pour les managers
Dans le monde des affaires, cette opposition éthique revêt une dimension stratégique. Doit-on licencier une partie des effectifs pour sauver l’entreprise (conséquentialisme), ou préserver coûte que coûte les droits des salariés (déontologisme) ?
La gouvernance d’entreprise, les politiques RSE et la prise de décision en situation de crise trouvent ici un terrain de réflexion éthique particulièrement fécond.
Vers une éthique hybride ?
La solution ne réside-t-elle pas dans une synthèse ? John Rawls, avec son principe de justice comme équité, propose une approche qui combine respect des droits fondamentaux (déontologisme) et recherche du bien commun (conséquentialisme). En somme, une éthique du « juste » plus que du « bien ».
Dans un monde où les dilemmes moraux se multiplient, cette approche nuancée offre un cadre pertinent, capable de guider l’action sans sombrer dans le dogmatisme ni dans le relativisme opportuniste.
Conclusion
Par conséquent, le déontologisme et le conséquentialisme structurent nos manières d’appréhender la justice, la responsabilité et la réussite. Maîtriser ces deux cadres de pensée, c’est comprendre que l’éthique ne se réduit ni à la pureté des intentions ni à l’efficacité des résultats.
C’est aussi accepter que, parfois, la bonne décision soit celle qui conjugue principes et pragmatisme. Dans la grande bataille des idées, le véritable stratège saura manier ces deux armes, non pas pour vaincre, mais pour convaincre.
Si cet article t’a été utile, tu peux également consulter nos articles consacrés aux prépas littéraires juste ici !