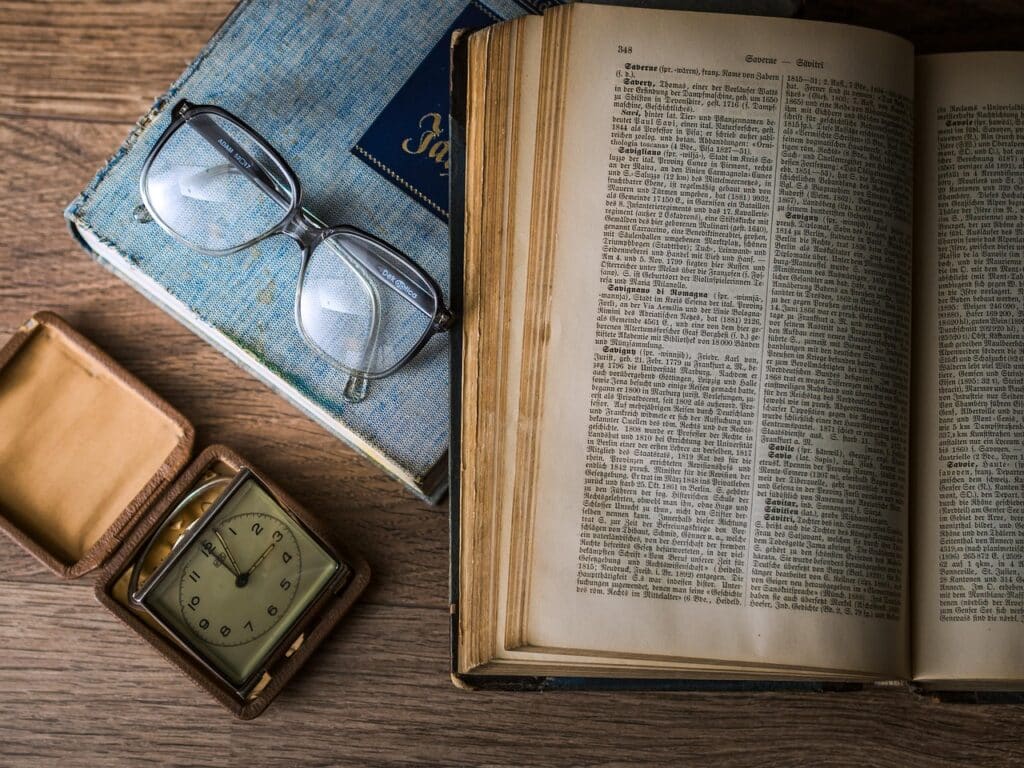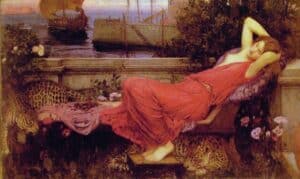Nous allons nous attarder sur la question de la valeur de l’œuvre littéraire, en lien avec l’axe au programme, « L’œuvre littéraire, ses propriétés, sa valeur ». La question à se poser ici est : mais qui en décide ? Qui détermine la valeur d’une œuvre littéraire ? Qui dit ce qui est de la littérature et ce qui n’en est pas ? On verra qu’il existe trois principaux types d’acteurs qui jugent de la valeur d’une œuvre : les critiques, les lecteurs et les écrivains.
Les critiques
Ce que nous appelons aujourd’hui la critique littéraire est une construction relativement récente. Si le terme lui-même possède une origine académique ancienne, la critique comme pratique professionnelle et journalistique naît véritablement au XIXᵉ siècle. Elle correspond à une volonté de professionnaliser l’analyse des textes, et donc de conférer à la littérature une valeur sociale et une légitimité comparable à celle des autres disciplines intellectuelles.
Une lente conquête de légitimité
Historiquement, la littérature a longtemps souffert d’un déficit de reconnaissance. Durant l’Ancien Régime, la production littéraire est considérée comme un artisanat manuel – donc subalterne – et perçue comme une activité dénuée de noblesse. Ce préjugé est tenace : la préface de L’Olive de Du Bellay dénonce ainsi « la fausse persuasion que l’art déroge à l’exercice de la noblesse ».
Au mieux, la littérature est vue comme un divertissement, une activité gratuite, non rentable et surtout réservée aux hommes, ce qui explique en partie la publication anonyme de certaines autrices, comme Madame de La Fayette, soucieuses de préserver leur respectabilité sociale.
La montée en puissance des « doctes »
Face à ce déni de valeur, la littérature cherche à se légitimer. Dès le XVIᵉ siècle, un mouvement d’autoréflexion littéraire apparaît : les traités d’art poétique (Peletier du Mans, par exemple) marquent la naissance d’un discours spécialisé. Leurs auteurs sont à la fois praticiens et théoriciens.
À partir du XVIIᵉ siècle, la légitimation s’institutionnalise avec la création d’académies, soutenues notamment par Richelieu. Ces institutions réunissent des spécialistes qui, progressivement, ne sont plus nécessairement des écrivains eux-mêmes. Cette dissociation introduit une valeur « objective » ou « scientifique » dans le discours critique (voir les travaux de Viala).
Ces académies ne produisent pas de littérature, mais bien des discours sur la littérature. Elles organisent des séances, salons, discussions collectives, souvent plus féconds que de longs traités. À partir d’œuvres particulières, elles dégagent des critères généraux de valeur, construisant ainsi les premières normes esthétiques. Leur objectif est clair : produire un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique. À l’origine, elles naissent souvent de cercles amicaux informels, qui se voient ensuite institutionnalisés – processus qui confère une légitimité accrue à leurs normes.
Le tournant de La Querelle du Cid (1636–1637)
La Querelle du Cid constitue un moment fondateur de la critique littéraire. Après la première représentation de la pièce en 1636, un vif débat éclate – attisé notamment par Georges de Scudéry. Pour arbitrer cette controverse, Richelieu demande à la toute récente Académie française (fondée par lui-même) de se prononcer. Ce geste inaugure une forme de critique institutionnelle. Le texte issu de cet examen, Les Sentiments de l’Académie française sur le Cid, marque à la fois l’acte de naissance de la critique officielle et l’affirmation des règles classiques.
Ironiquement, on reproche à Corneille d’avoir transgressé des normes… qui ne sont pas encore clairement établies. Cette tension révèle un des problèmes centraux de la critique : la production de normes contraignantes, souvent en décalage avec l’acte créatif. Par ailleurs, l’État devient un acteur central de la vie littéraire, en tant que principal producteur de textes et de règles, à travers le mécénat et les institutions officielles. La littérature devient alors « officielle », et sa valeur dépend en partie de sa reconnaissance par le pouvoir.
Le rôle de la presse : naissance de la critique moderne
À partir du XIXᵉ siècle, la presse connaît un fort développement et devient un nouvel espace de diffusion de la critique. Cela permet aux critiques d’élargir leur influence, en s’adressant à un public plus vaste. Toutefois, la presse est encore soumise à la censure, ce qui incite les journalistes à traiter de sujets littéraires plutôt que politiques.
C’est dans ce contexte que se creuse une rupture entre écrivains et critiques. Les journaux deviennent le lieu de polémiques et d’oppositions esthétiques : Nisard contre les Romantiques, Sainte-Beuve contre Balzac, etc. Le vocabulaire critique lui-même évolue : des termes comme classicisme (opposé au romantisme) ou fumisme (lié à Verlaine et Rimbaud) naissent dans le cadre journalistique.
Les critiques sont parfois perçus comme des écrivains ratés ou mineurs, cherchant à exercer leur pouvoir dans le champ littéraire (cf. Pierre Bourdieu). La critique devient alors rivale de la création. Balzac, dans ses Illusions perdues, illustre parfaitement ce conflit, en montrant que la presse est dépendante des logiques économiques, des directeurs de journaux, et que la valeur d’un texte peut être dictée par des intérêts commerciaux.
Les lecteurs
Au-delà des critiques, parmi les différents « juges » de la littérature, le lectorat joue un rôle fondamental. Mais il convient de distinguer plusieurs types de valeurs.
Le succès commercial ne garantit en rien une valeur esthétique ou littéraire. Par exemple, Anatole France était un auteur extrêmement lu au début du XXᵉ siècle, mais il est aujourd’hui largement tombé dans l’oubli. À l’inverse, les poètes de la Pléiade, peu lus pendant plusieurs siècles, sont désormais considérés comme des figures majeures du patrimoine littéraire français.
La popularité immédiate peut même être perçue comme un facteur de dévalorisation. Certains auteurs très lus – comme Marc Lévy ou Guillaume Musso aujourd’hui, ou Michel Butor à une époque – sont peu présents dans les études universitaires.
Comme le souligne Butor, la littérature commerciale est conçue pour s’adapter aux goûts du public, ce qui nuit à sa pérennité. Elle suit les modes, mais ne les transcende pas.
Le paradoxe du succès
Pourtant, Baudelaire propose une autre vision : il affirme que l’on peut saisir « l’air du temps » pour en tirer une œuvre durable. L’adaptation ne serait donc pas forcément synonyme de compromission, mais pourrait devenir un principe esthétique.
Butor, au contraire, insiste sur la tension entre création littéraire et recherche du succès. Il analyse le malaise de certains auteurs dits « populaires », comme Eugène Sue, qui tentent de produire des œuvres plus sérieuses pour gagner en légitimité… souvent sans y parvenir.
Pour Butor, le véritable écrivain est celui qui n’écrit pas en fonction d’un lectorat ciblé, mais qui s’adresse à un lecteur inconnu – voire inattendu. L’auteur authentique écrit sans chercher à plaire : c’est le texte lui-même qui révèle après coup son public. Vouloir plaire revient à se plier à des recettes et à des normes, ce qui est, pour lui, une démarche méprisable.
Le lecteur modèle (Umberto Eco)
À l’opposé, Umberto Eco affirme que tout texte suppose un « lecteur modèle », c’est-à-dire un lecteur idéal, construit par l’auteur à travers ses choix d’écriture.
Par exemple, dans ses Fables, La Fontaine écrit pour le Dauphin, fils de Louis XIV. Ce choix lui donne un prestige certain, mais pose aussi un problème : ses fables sont-elles seulement destinées à des enfants ? Cette ambivalence est compensée par la multiplication des dédicaces, qui permet de dessiner plusieurs figures possibles du lecteur modèle.
La question du travail en littérature
Enfin, une opposition structurante traverse l’histoire littéraire. D’un côté, une vision de la littérature comme don naturel ou inspiration divine (la figure de la « muse »), où le travail est minimisé. De l’autre, une conception littéraire comme art exigeant, fondée sur l’effort et la rigueur.
Boileau incarne cette dernière posture : « Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage », écrit-il dans son L’Art poétique. La valeur littéraire se situe ici dans la recherche formelle et le travail du texte.
Les écrivains
Finalement, un dernier acteur émerge de cette étude : l’écrivain lui-même. Certains critiques sont eux-mêmes écrivains, et vice-versa, ce qui leur confère une légitimité particulière. Leur discours critique s’inscrit dans une relation de pair-à-pair, au sein d’un champ littéraire structuré par les écoles, les mouvements, les affiliations.
L’école littéraire comme système de cooptation
La reconnaissance passe souvent par une forme de cooptation symbolique. S’affilier à un courant, à une esthétique, ou à un auteur, permet d’inscrire son œuvre dans une tradition valorisante. Les Soirées de Médan, où Zola, en chef de file du naturalisme, consacre ses suiveurs, en est un exemple emblématique. La valeur littéraire est alors produite par le rapprochement des auteurs.
Ce phénomène se manifeste aussi dans l’intertextualité : les références à d’autres œuvres (hommage, détournement, pastiche, parodie) permettent à l’auteur de se situer dans le champ littéraire, tout en revendiquant une originalité.
Le critique idéal : l’écrivain (selon Balzac)
Pour Balzac, le seul vrai critique est l’écrivain. Il possède une connaissance pratique des moyens de l’art, et peut donc analyser une œuvre de l’intérieur.
Le journaliste, en revanche, manque de cette expérience : son discours critique reste extérieur, et donc moins légitime. C’est pourquoi les écrivains échangent entre eux – Maupassant envoie ses textes à Flaubert, Henri Michaux attend les réactions de Michel Leiris, etc.
La critique comme prolongement de l’œuvre
Pour beaucoup d’écrivains, la critique est une forme de création. Elle devient un laboratoire pour l’élaboration de leur propre œuvre. Ainsi, dans Contre Sainte-Beuve, Proust critique Nerval – mais à travers cette critique, c’est une ébauche d’À la recherche du temps perdu qui se dessine. En parlant des autres, l’écrivain parle de lui-même.
La critique est alors un lieu de réflexion sur l’écriture, sur ce que signifie « écrire », sur la posture de l’auteur et la fabrique du style.
Conclusion
On voit bien que la question de la valeur littéraire ne peut recevoir de réponse unique : elle résulte d’un jeu complexe entre plusieurs instances de légitimation. Les critiques, en institutionnalisant un discours sur les œuvres, ont historiquement cherché à imposer des normes, souvent au service d’une vision académique ou étatique de la littérature. Le lectorat, quant à lui, juge par l’usage, offrant à certaines œuvres un succès immédiat – qui ne garantit ni profondeur ni postérité. Enfin, les écrivains eux-mêmes, lorsqu’ils sont ou se font critiques, apparaissent comme les seuls à pouvoir parler de l’intérieur de la création : leur regard engage une connaissance intime du geste littéraire.
Ainsi, la valeur d’une œuvre se construit dans un dialogue permanent entre ces trois pôles (critiques, lecteurs, écrivains), aucun pouvant à lui seul en détenir l’autorité absolue. Cette pluralité des regards souligne une vérité essentielle : la littérature est un champ mouvant, traversé par des tensions entre institution, réception et création, où la valeur se négocie, se discute, se transforme. En définitive, ce n’est pas une instance qui décide, mais une dynamique collective – historique, sociale et esthétique – qui confère aux œuvres leur poids et leur place dans le temps.