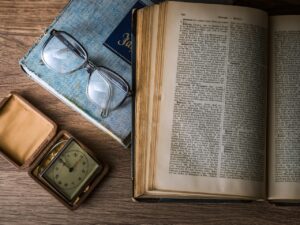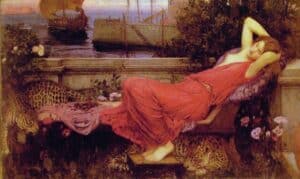Contes de fées de Madame d’Aulnoy appartient à cette catégorie d’œuvres faussement naïves, où le charme du style masque une vraie subversion. Au XVIIe siècle, dominé par les codes masculins de la galanterie, la raison classique et les grandes fresques historiques, Madame d’Aulnoy glisse ses héroïnes travesties, ses ogres sentimentaux et ses intrigues bien ficelées dans des salons feutrés. Or, si l’on rit et rêve, on pense aussi. En effet, Contes de fées est une œuvre qui engage une vision du monde, de la société et surtout de la condition féminine à l’aube du siècle des Lumières.
L’autrice
Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, comtesse d’Aulnoy, est une femme du Grand Siècle, mais hors de ses sentiers battus. Née en 1652, elle est bien née, bien mariée, mais surtout bien décidée à écrire autrement.
Entre mondanité et marginalité, elle fréquente les salons où les femmes tiennent la plume aussi bien que les hommes, mais elle n’a pas les faveurs des institutions classiques : pas d’Académie, pas de tragédie, mais des contes. Madame d’Aulnoy ne cherche pas l’élévation morale du théâtre racinien ni le naturalisme balbutiant des moralistes : elle enchante pour mieux critiquer.
L’œuvre : des fables politiques
Contes de fées (expression que Madame d’Aulnoy contribue à populariser) regroupe un ensemble de récits composés entre 1690 et 1709, souvent publiés en recueils. Le terme contes est trompeur. Il ne s’agit pas ici de récits oraux transmis par le peuple, mais de textes raffinés, écrits, ancrés dans la tradition mondaine et littéraire. Le style est travaillé, riche et orné.
Loin de Perrault, Madame d’Aulnoy ne cherche pas la brièveté ni la moralité : elle déploie, détaille et invente. Ses contes sont des labyrinthes baroques où les princesses ont du caractère, où les fées ont des failles et où le merveilleux se fait le miroir. Mais un miroir déformant évidemment. Il ne s’agit donc pas de rêver, mais de faire rêver autrement.
Le merveilleux : un genre au cœur de la subversion
Le merveilleux, notion centrale du programme 2026, trouve dans l’œuvre de Madame d’Aulnoy un terrain de jeu et de réflexion idéal. Si l’on suit la définition traditionnelle, le merveilleux se caractérise par l’acceptation, sans étonnement, d’éléments surnaturels dans un univers cohérent.
Mais chez Madame d’Aulnoy, il devient outil critique. Le merveilleux est un décor : châteaux mouvants, animaux parlants, métamorphoses improbables. Mais il est surtout une stratégie : celle de dire l’indicible, à savoir le désir féminin, l’injustice des mariages arrangés, la violence symbolique du pouvoir. En cela, Madame d’Aulnoy détourne le merveilleux pour en faire un contre-pouvoir : un espace de résistance féminine, un théâtre d’émancipation masquée. On pense à La Chatte blanche, où l’héroïne se transforme pour fuir un père oppresseur. À L’Oiseau bleu, où la métamorphose devient réversible, souple, choisie.
Un conte est un contrat
Lire Madame d’Aulnoy, c’est accepter un double pacte. D’abord, un pacte de fiction : on accepte que les roses parlent, que les fées fassent la loi, que les princes soient souvent bêtes et les princesses rusées. Mais c’est aussi un pacte critique : sous la parure narrative, une remise en question. L’écriture de Madame d’Aulnoy est résolument féminine, non par essentialisme, mais par choix esthétique et politique. Elle prend la parole, là où tant d’autres l’avaient confisquée. Le merveilleux devient alors une langue parallèle, un espace de négociation du réel. Chaque conte est une mise en scène du pouvoir, de ses abus et de ses failles.
Enfin, le style, qui est souvent négligé, est l’un des charmes (et des pièges) de ces contes. D’une grande richesse syntaxique, truffé de digressions, de descriptions minutieuses et de dialogues enlevés, il exige une lecture active. Loin d’une naïveté première, ce style « fleuri » est une arme de subtilité. Il faut, comme le lecteur de salon du XVIIe siècle, apprendre à lire entre les lignes.
En somme, Contes de fées est une œuvre à double fond : un miroir enchanté, mais aux reflets souvent amers. L’œuvre de Madame d’Aulnoy apparaît donc comme un laboratoire du genre : hybride, féministe avant l’heure et dérangeant sous ses paillettes.