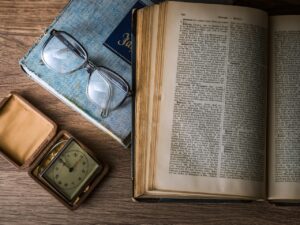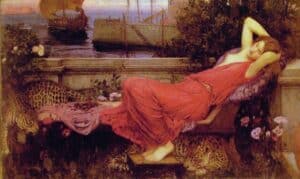Dans le cadre de la préparation des oraux, nous te proposons dans cet article quelques clés d’analyse du style d’Annie Ernaux, si tu venais à tomber sur l’un de ses textes. Tu trouveras les grandes caractéristiques de son écriture, de façon à nourrir ton analyse de termes précis et techniques.
L’écriture plate
Le style d’Annie Ernaux est communément considéré comme une écriture plate. Il s’agit d’un terme utilisé par l’autrice, et non par un théoricien de la littérature. Ce terme apparaît dans son premier roman La Place publié en 1983.
« Pour rendre compte d’une vie soumise à la nécessité, je n’ai pas le droit de prendre d’abord le parti de l’art, ni de chercher à faire quelque chose de “passionnant”, ou d’“émouvant”. […] Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L’écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j’utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. »
Dans ce passage, Annie Ernaux souligne l’importance de ne pas raconter avec une écriture trop touffue, trop riche ou trop lyrique. L’objectif est double. D’une part, elle souhaite rester au plus près du réel et le dépeindre avec véracité, d’autre part, elle s’attache à rejeter toute écriture trop littéraire qui trahirait sa classe d’origine.
La position d’Annie Ernaux est éminemment politique et doit être lue dans une perspective sociologique. En effet, elle utilise l’écriture comme un instrument de différenciation et de lutte sociales pour renverser le rapport de force entre dominants et dominés. Elle se pose volontairement à côté, en deçà de la littérature traditionnelle pour donner une voix aux silenciés et offrir une autre façon d’appréhender le langage.
De cette façon, Annie Ernaux est dans une « posture d’écriture », selon ses propres mots. Elle produit un discours dont la conception prend racine dans des revendications sociopolitiques. L’objectif étant de pousser, à terme, à l’action, à la praxis grecque au sens arendtien du terme. Ses livres constituent une véritable scène d’énonciation littéraire et politique, un exercice de style destiné à agir, et non à rester cantonné à une dimension purement esthétique.
La simplicité comme racine du style ernaldien
Annie Ernaux a recours dans ses livres à un style volontairement simple (en latin genus humile). Cette écriture ethnologique peut être rapprochée de la traditionnelle classification de la roue de Virgile.
Cette tripartition stylistique fonctionnait comme suit : le guerrier devait parler dans un style élevé (miles dominans), le paysan laborieux dans un style moyen (agricola) et le berger dans un style simple (pastor otiosus). Cette division repose sur le principe aristotélicien de l’adaptation nécessaire du style au sujet traité. Ce qui est très précisément la façon de procéder d’Annie Ernaux.
C’est par exemple la dynamique que l’on retrouve chez Joachim du Bellay
Dès les premiers sonnets des Regrets, il prend position contre une écriture métaphorisante qui désigne et transforme ce qu’elle nomme directement. Ainsi, en cherchant à éliminer l’écart entre les mots et lui-même, il rompt définitivement avec la tradition platonicienne de l’emportement et du délire en faveur d’une poétique de resserrement.
Il renonce à une mythologie d’emprunt (les métamorphoses de Sisyphe, Ixion ou Tantale) et un langage d’emprunt (celui de Properce ou de Tibulle) pour se présenter désormais sous des figures et dans un langage dépouillé :
« Aussi veulx-je que ce que je compose/Soit une prose en ryme ou une ryme en prose/Et ne veulx pour cela le laurier mériter. » (II) (1)
Cette déclaration n’implique nullement une poésie sans artifice. Elle signale plutôt une réaction contre la dispersion de soi qu’entraîne l’écriture pétrarquiste. Les premiers sonnets des Regrets contiennent donc une réflexion sur leur démarche. Du Bellay s’astreint à y définir un nouveau langage.
Plutôt que de présenter son sujet, il s’interroge sur le moyen de le représenter, ce qui entraîne des vers essentiellement analytiques. Il s’efforce d’investir d’un signe positif son attitude à l’égard d’une écriture métaphorisante, de délimiter et de justifier une poétique du dépouillement. Contrairement à l’ordre moral de la création, le métalangage précède le langage, mais sans nous renseigner directement sur le langage proféré. Il s’agit très exactement de ce qui préoccupe Annie Ernaux dans son travail d’écriture.
La pratique d’écriture d’Annie Ernaux
Dans Les Années, elle inscrit sa pratique d’écriture dans la même perspective. Comme Du Bellay, elle décrit ce lieu qu’on a quitté et qu’on regrette, alors qu’il s’agit d’un champ de ruines.
Ce travail sur ce qui n’est plus rappelle l’odyssée d’Ulysse, qui engendre souffrance et regrets, mais qui oblige à avancer, car c’est le seul moyen de retrouver un foyer. Et pour se concentrer sur la vérité du sentiment à l’égard du passé, il convient d’utiliser un langage sans artifice au plus près du réel.
C’est ce vers quoi tend Annie Ernaux au début de son œuvre Les Années :
« Ce ne sera pas un travail de remémoration, tel qu’on l’entend généralement, visant à la mise en récit d’une vie, à une explication de soi. Elle ne regardera en elle-même que pour y retrouver le monde, la mémoire et l’imaginaire des jours passés du monde, saisir le changement des idées, des croyances et de la sensibilité, la transformation des personnes et du sujet, qu’elle a connus et qui ne sont rien, peut-être auprès de ceux qu’auront connus sa petite-fille et tous les vivants en 2070. Traquer des sensations déjà là, encore sans nom, comme celle qui la fait écrire. »
L’usage du sociolecte
Annie Ernaux a recours dans son œuvre au sociolecte (usage langagier d’un groupe social) de son milieu d’origine. Elle utilise un ensemble d’expressions qui mettent en valeur des figures stéréotypiques et représentatives d’une classe sociale, d’un lieu ou d’une époque. De cette manière, sans avoir recours à un style explicatif, elle révèle ainsi un type d’éthos sociologique et historique qui éclaire le lecteur.
Ce sociolecte est modalisé selon différentes formes
La citation entre guillemets
« Au souper, il fallait nous arracher les mots de la bouche, on laissait de la nourriture, s’attirant le reproche “si tu avais eu faim pendant la guerre tu serais moins difficile”. Aux désirs qui nous agitaient était opposée la sagesse des limites, “tu demandes trop à la vie”. » Les Années, Folio, 2008
« Le sexe était le grand soupçon de la société qui en voyait les signes partout, dans les décolletés, les jupes étroites, le vernis à ongles rouge, les sous-vêtements noirs, le bikini, la mixité, l’obscurité des salles de cinéma, les toilettes publiques, les muscles de Tarzan, les femmes qui fument et croisent les jambes, le geste de se toucher les cheveux en classe, etc. Il était le premier critère d’évaluation des filles, les départageait en “comme il faut” et “mauvais genre”. » Les Années, Folio, 2008
L’italique
« Pour mon père, le patois était quelque chose de vieux et de laid, un signe d’infériorité. Il était fier d’avoir pu s’en débarrasser en partie, même si son français n’était pas bon, c’était du français. […] Quand le médecin ou n’importe qui de haut placé glissait une expression cauchoise dans la conversation comme “elle pète par la sente” au lieu de “ elle va bien”, mon père répétait la phrase du docteur à ma mère avec satisfaction, heureux de croire que ces gens-là, pourtant si chics, avaient encore quelque chose de commun avec nous, une petite infériorité. Il était persuadé que cela leur avait échappé. » La Place, Folio, 1983
Le discours rapporté, second et plus distancié
« Au sortir de la guerre, dans la table sans fin des jours de fête, au milieu des rires et des exclamations, on prendra bien le temps de mourir, allez ! La mémoire des autres nous plaçait dans le monde. » Les Années, Folio, 2008
Conclusion
Pour conclure, Annie Ernaux revendique une écriture infra-littéraire inscrite dans une dimension à la fois sociologique, politique et historique. Son écriture est déterminée par des figures microstructurales qui influencent ensuite le mode d’énonciation total du récit. Il convient donc toujours de relier les éléments rhétoriques à un contexte métatextuel plus large.
Si cet article t’a été utile, tu peux également consulter nos fiches de lecture sur L’Événement et L’Écriture comme un couteau d’Annie Ernaux. Tu peux accéder à nos articles dédiés aux prépas littéraires juste ici !