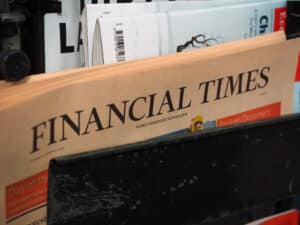Major Prépa > Grandes Écoles > Témoignage : intégrer une école de journalisme après une prépa littéraire

Tu es en khâgne A/L ou B/L et tu souhaites devenir journaliste ? Parmi les écoles de journalisme reconnues par la profession, douze sont accessibles après un Bac +3. Chaque année, les anciens khâgneux sont nombreux à les intégrer en M1.
Aujourd’hui, nous te proposons d’en apprendre plus sur les débouchés dans le journalisme après la prépa à travers le témoignage de Tiphaine et Camille. Anciennes élèves de prépa A/L et B/L, elles sont aujourd’hui étudiantes à l’Institut pratique du journalisme qui dépend de l’Université Paris Dauphine – PSL.
Une petite présentation pour commencer : quel a été votre parcours scolaire du lycée jusqu’à la prépa ?
Tiphaine : J’ai un parcours de lycée un peu particulier… J’ai fait une première scientifique et une terminale littéraire. J’aimais beaucoup la philo et je voulais devenir prof. C’est pour ça que j’ai fait une hypokhâgne A/L.
J’étais au lycée Claude Monet (Paris, 13e) en première année, ensuite, je suis partie au lycée Jules Ferry (Paris, 9e) parce qu’on y proposait la spé philo. J’y étais en carré et ensuite en khûbe. C’était une khâgne moderne qui préparait à l’ENS de Lyon. J’ai bien aimé découvrir plein de choses en géo ou en sciences humaines.
Camille : Pendant longtemps je ne savais pas ce que je voulais faire, donc j’ai fait un bac S pour ne me fermer aucune porte. J’étais en spé SVT, la littéraire des scientifiques. Tout se passait bien, mais en maths c’était compliqué et je n’ai eu que 11 au bac. Ça ne m’a pas empêchée d’aller en prépa B/L !
C’était le choix logique pour moi parce que j’étais plutôt scolaire et je voulais passer le concours des IEP pour devenir journaliste ou travailler dans la politique. J’étais à Jacques Amyot (Melun) au lycée, donc je suis restée là-bas pour ma prépa. J’ai fait l’option anglais renforcé.
Comment se déroule un cursus en école de journalisme ?
Tiphaine : Toutes les écoles sont très orientées vers la pratique. Dès le début de ta première année, tu vas être amené à être sur le terrain, faire des interviews, aller à la rencontre des gens, etc. C’est très diversifié, avec de la télé, de la radio et de l’écrit sur des thématiques différentes. L’année de M1, tu testes plein de choses différentes pour voir ce qui te parle le plus et quels sont tes axes d’amélioration.
Camille : À l’Institut pratique du journalisme (IPJ), la plupart des élèves suivent un cursus en 2 ans. Certains prennent une année de césure en plus entre le M1 et le M2. Comme dans beaucoup d’écoles, la première année est généraliste. Tu t’entraînes à la télé, à la radio et à la presse écrite. Même s’il y a aussi des matières un peu plus théoriques, ce sont toujours des enseignements reliés à ce qu’on fera. C’est aussi ça qui est agréable !
En M2, tu dois choisir entre les spés radio, télé et presse écrite. À l’IPJ, il y a aussi trois parcours plus théoriques qui sont proposés :
- journalisme économique et social ;
- journalisme politique et social ;
- journalisme international.
Il existe ensuite toute une flopée de plus petites options qui vont du journalisme culturel à la police-justice, en passant par l’environnement ou le sport.
Avez-vous présenté les concours des écoles de journalisme pendant que vous étiez en prépa ?
Camille : Je n’ai pas pu, parce que pour intégrer la plupart des écoles, il faut avoir validé 180 crédits universitaires, l’équivalent d’un Bac +3. Je me suis posé la question de passer les concours pendant ma khûbe ou de partir en licence pour m’y consacrer plus pleinement.
Mais j’avais peur que passer les écoles de journalisme ne soit pas compatible avec la préparation de l’ENS ou des écoles de commerce que je ne voulais pas intégrer de toute façon. J’ai donc intégré une licence d’espagnol à la Sorbonne (Paris IV). Pendant ma L3, j’ai participé à un atelier radio organisé dans ma fac par Thomas Schnell, journaliste à BFM Business. J’ai aussi participé à un évènement avec des étudiants en école. Ma licence d’espagnol me prenait beaucoup de temps, mais une élève de l’IPJ m’a convaincue de tenter quand même les concours en parallèle. À la base, c’était vraiment un test qui s’est finalement très bien déroulé !
Tiphaine : En ce qui me concerne, je me suis dit que j’allais passer les concours quand j’étais en khûbe. Le problème des 180 crédits universitaires ne s’est donc pas posé. La préparation des dossiers et des épreuves de journalisme était un peu compliquée parce que je passais l’ENS en même temps. Je voyais plus mes candidatures aux écoles comme une première tentative un peu pour du beurre. Je voulais mieux cerner quelles étaient les attentes aux épreuves.
Je n’ai pas réussi les concours à ma première tentative, donc j’ai intégré un master de philosophie politique et sociale à Nanterre. À la fac, je me suis rendu compte que le professorat ne me conviendrait vraiment pas. J’ai arrêté les cours, fait plusieurs stages et suivi la prépa de l’École W. De novembre à mai, j’avais des cours deux soirs par semaine et parfois le samedi.
Pourquoi être allées dans cette licence/ce master et qu’est-ce qui vous a poussées à intégrer l’IPJ en particulier ?
Camille : J’ai choisi l’espagnol parce que c’était une matière qui m’intéressait et je pensais qu’elle me laisserait le temps de préparer au mieux les concours. C’était vraiment pour concilier praticité, tout en me donnant l’opportunité d’aller bosser à l’étranger un jour.
À la sortie du master, j’ai envie de bouger et d’être reporter radio sur le terrain pour traiter des sujets en France ou dans d’autres pays. L’IPJ est une école qui m’a tout de suite plu pour sa bienveillance, mais aussi parce qu’elle offre la possibilité de faire une alternance en deux ans.
Tiphaine : Honnêtement, j’ai choisi mon master de philo un peu par défaut. Je ne voyais pas trop ce que j’aurais pu faire d’autre. C’était ma spé en khûbe et la matière où je me débrouillais le mieux. Ça m’aura au moins permis de réaliser que ça n’était pas une option professionnellement et que je voulais vraiment faire du journalisme !
Comme Camille, j’ai aussi choisi la spé radio. À la fin de mon M2, je voudrais plus particulièrement bosser sur des sujets police-justice. J’ai voulu intégrer l’IPJ parce que l’école nous apprend aussi à avoir un regard critique sur l’activité journalistique. On nous pousse à réfléchir sur nos pratiques et à questionner nos conditions de travail futures. Par exemple, il y a pas mal de cours ou de conférences sur les violences sexistes et sexuelles dans les médias.
Est-ce que le choix de licence/master que vous avez fait après la prépa a été déterminant pour obtenir ensuite une école de journalisme ?
Tiphaine : Il faut vraiment faire quelque chose qui t’intéresse. Ça peut être des lettres, de l’histoire, de la philo, etc. L’erreur serait, selon moi, de choisir quelque chose qui te déplaît par pure stratégie. Ça ne sert à rien d’avoir un profil « rare » avec une licence insolite si ton cursus à la fac ne te plaît pas. Ce qui fait la différence, c’est de montrer que tu as choisi un sujet qui t’a épanoui et t’a vraiment apporté quelque chose.
Camille : Totalement d’accord ! À l’automne dernier, j’ai été à un forum d’orientation dans mon ancienne prépa et j’ai conseillé aux personnes à qui j’ai parlé de choisir un sujet qui les fait vibrer. Peu importe le parcours en soi, ce qui compte, c’est la connaissance du métier, la motivation et le lien que tu arrives à faire entre tes études après la prépa et le journalisme.
Comment s’est déroulée votre première année de master, êtes-vous contentes de votre école ?
Tiphaine : Ça s’est plutôt très bien passé ! Je fais quelque chose que j’adore et dans lequel je crois. L’année a été très enrichissante parce que j’ai découvert énormément de choses. Un jour, on parle écologie, le lendemain économie et après culture. On a aussi beaucoup bossé en groupe. C’était comme une grosse colonie de vacances avec le travail en plus !
L’année m’a appris que c’était important d’être ouvert et de ne pas être buté sur ce qu’on veut faire ou ne pas faire. Avoir des sujets fétiches où on a une petite expertise et des contacts, c’est primordial. Mais il faut aussi être à l’affût des opportunités qui existent en dehors de notre domaine de spécialité.
Camille : Je ne regretterai jamais d’avoir intégré l’IPJ ! Je sens que je suis là où je devais être. L’année a été géniale sur le plan des enseignements. Je me suis rendu compte que j’ai trouvé ma voie. L’école est fidèle à mes attentes. Évidemment, tout n’est pas parfait, mais c’est comme partout et ça ne me dérange pas. Le M1 de journalisme est sans aucun doute le meilleur choix que j’ai fait dans mon parcours scolaire.
Les compétences développées en khâgne sont-elles utiles en journalisme ?
Tiphaine : Je pense qu’en prépa, on acquiert plein de qualités précieuses pour un journaliste. La première, selon moi, c’est la rigueur de travail. Même si les tâches du khâgneux et du journaliste sont très différentes, elles requièrent toutes les deux une grande ténacité.
La khâgne apprend aussi l’esprit de synthèse. On a l’habitude de sélectionner des idées et de les restituer. Toutes nos dissertations se construisent autour d’infos hiérarchisées selon un plan de réflexion. Savoir catégoriser les données pour en rendre compte, c’est une qualité très importante en journalisme.
Camille : C’est clair ! Cette manière de penser et d’articuler ses idées est capitale en journalisme. J’ajouterais que la prépa entraîne aussi très bien à l’expression orale. C’est indispensable dans le journalisme, mais aussi pour passer les concours des écoles.
Ce qui est sûr, c’est que les écoles aiment bien les profils d’ex-khâgneux. On est plusieurs dans notre promo à l’IPJ et pour certaines de mes candidatures à des alternances radio, on m’a conseillé de mettre en avant mon passage par la prépa dans mon CV et ma lettre de motivation.
Quels conseils donneriez-vous aux khâgneux qui veulent intégrer une école de journalisme ? Quelles sont les qualités nécessaires pour intégrer ?
Tiphaine : Pour passer de la khâgne au journalisme, il faut déconstruire tout un tas de réflexes. Notamment parce qu’en prépa, la hiérarchie de l’information est inversée. Tu atteins l’apogée de ton raisonnement en conclusion et tu ne donnes la réponse à la problématique qu’à la fin. En journalisme, le plus important est mis au début de l’article. Ensuite, ton but est de retracer les étapes par lesquelles tu es passé pour en arriver là. Le chemin à suivre est l’opposé de celui à prendre dans une copie de khâgne.
L’autre élément important, c’est la manière d’écrire. En prépa, on fait de très longues copies de 12, 15, voire 20 pages. En journalisme, il faut être beaucoup plus efficace et aller à l’essentiel tout de suite. La concision et la précision sont la clé. Le journaliste doit parler à tout le monde et être compris du grand nombre. On est souvent loin du langage très érudit des copies des khâgneux qui ne s’adressent qu’à des initiés.
Camille : Il faut vraiment être beaucoup plus direct dans ses propos. Les copies de prépa sont parfois un peu opaques et centrées sur des sujets archi-conceptuels. En journalisme, il faut toujours illustrer sa démonstration par des exemples concrets. Autre truc important : il faut oser. Et cette audace, c’est parfois ce qui manque en khâgne où les attentes et les concours sont très normés.
Comment s’était déroulée votre prépa ?
Tiphaine : De l’hypokhâgne à la khûbe, tout s’est bien passé, mais c’est surtout parce que je n’étais pas dans une grande prépa parisienne. L’accompagnement était toujours très positif et il n’y avait pas de pression insoutenable.
J’étais une élève très curieuse, mais pas toujours très sérieuse. Il y avait des matières qui me plaisaient plus que d’autres. J’étais vraiment très nulle en espagnol, donc je bossais moins. Je ne me collais pas trop la pression et quand les choses ne me semblaient pas super intéressantes, je ne m’acharnais pas forcément. Je n’ai pas fait ma prépa pour intégrer absolument l’ENS et c’est pour ça que je l’ai vécue positivement. Comme j’étais un peu flemmarde, mes résultats étaient assez moyens, mais ça ne m’a pas empêchée de tirer plein de positif de mes trois ans ! À l’arrivée, je ne m’en sors pas moins bien que ceux qui étaient en tête de classe.
Camille : J’avoue que je me collais un peu plus la pression. Je ne m’autorisais pas à ne pas réussir à la hauteur de mes espérances et j’étais ultra-dure avec moi-même. Même quand j’avais une bonne note, je trouvais toujours le moyen de me dire que le sujet était facile, que j’avais eu de la chance. C’était dur de prendre du recul sur mes notes.
Ma première année s’est quand même super bien passée. J’avais des matières où je réussissais mieux que d’autres, mais j’ai eu la chance que mon confinement se passe bien. J’ai fini l’hypo troisième de ma classe et c’était une petite fierté !
La khâgne a été beaucoup plus dure parce que les profs étaient vraiment en démarche concours. Ils étaient beaucoup plus stricts et sévères. J’avais des petits soucis sur le plan perso qui se sont ajoutés et le premier semestre a été très difficile. Je n’ai repris du poil de la bête qu’à partir du moment où j’ai réussi à me mettre moins de pression sur les résultats et à me foutre du classement.
Quels conseils donneriez-vous à des hypokhâgneux ou khâgneux sur la prépa en général ?
Camille : Justement, de dédramatiser la classe préparatoire ! Il faut savoir prendre un peu de hauteur, souffler et ne pas donner à la chose plus d’importance qu’elle n’en mérite. Intégrer l’ENS n’est pas une fin en soi et la prépa est fantastique aussi parce qu’elle apporte énormément de choses au-delà des concours. Il faut voir ça comme un bagage de culture générale et une méthode de travail. Il faut profiter des enseignements pour ce qu’ils sont en essayant de ne pas trop se coller la pression.
Tiphaine : Je suis 100 % d’accord. Pour bien vivre sa prépa, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Il faut garder en tête que ce ne sont que deux ou trois ans sur toute une vie. Ce qui semble énorme sur le moment semblera tout petit demain. Rater une dissert, une khôlle ou ne pas majorer, ce n’est pas très grave et ce n’est pas ça qu’on retiendra dans dix ans.
Il faut profiter des années prépa pour réfléchir aussi à d’autres débouchés que l’ENS. On la présente parfois comme le bout de tout, alors que ça ne concerne que peu de personnes. La prépa a plein de portes de sortie différentes et qui ne demandent pas toutes les mêmes qualités. Il faut garder toujours l’esprit ouvert à toutes les possibilités qui s’ouvrent à soi.
Un grand merci à Camille et Tiphaine pour leur témoignage sur leur expérience en prépa et sur leur cursus à l’Institut pratique du journalisme ! Pour trouver d’autres articles sur les prépas littéraires, rendez-vous ici !