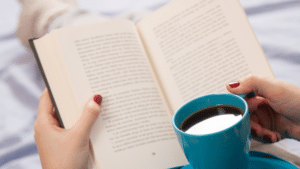C’est officiel : après “La violence”, “L’image” est au programme de l’épreuve de Culture Générale 2025.
Notion cruciale dans l’histoire de la philosophie, et, évidemment, en art – et notamment en peinture et en cinéma -, cette belle notion vous fera voyager à travers la philosophie de l’art bien sûr, mais aussi la métaphysique ou encore la philosophie politique. Elle regroupe en effet des questions allant du problème de la représentation au rapport entre l’apparence et le réel, en passant par les considérations esthétiques (qu’est-ce qu’une belle image ?) et éthiques (faut-il aimer l’image, et qu’aime-t-on lorsqu’on l’aime : l’imagé ou l’imageant ?).
Lire aussi : Le Plan de travail sur l’année pour L’image
Préambule : aborder la notion “L’image” pour préparer sa rentrée
En guise de conseils introductifs, nous vous recommandont le corpus de textes sur la notion publié en GF. Il regroupe une introduction de la notion, ainsi que plusieurs auteurs et thématiques expliqués, qui permettront de vous constituer une base d’exemples philosophiques afin de problématiser et de traiter vos sujets de dissertation dès la rentrée.
Vous pourrez également consulter le podcast de Major-Prépa consacré à la notion et préparé par des enseignants en Culture Générale, qui abordera, en 12 épisodes, des exemples littéraires, artistiques et philosophiques divers. Enfin, pensez également vous aider de vos cours de première année, ainsi que de ceux de Terminale : sur “L’art”, “La technique” , mais aussi sur “Le temps”, “La raison” et “La vérité”. C’est que la notion d’image est en effet d’abord apparue, chez les Grecs, pour interroger notre rapport au réel.
L’image, entre apparence et réalité
Commençons par une petite enquête éthymologique : si elle ne remplace pas une analyse de la notion per se, elle permet tout de même d’en livrer une première définition.
L’imago, ou représentation : la présence de l’absence
Le terme d’image provient du latin imago : il s’agit, littéralement, d’une représentation. L’image est donc d’abord ce qui donne à voir quelque chose d’autre : elle est donc l’apparence d’un objet qui lui, ne lui est pas identique. Autrement dit, il y a toujours un écart entre l’imagé et l’imageant. Le premier problème que pose l’image est donc celui de son degré ontologique : quelle est la réalité que l’image nous donne-t-elle à voir – et s’agit-il seulement d’une réalité ? L’image étant toujours une représentation, c’est-à-dire en fait une imitation, a-t-elle pour elle-même une réalité ?
C’est là qu’intervient alors cette distinction grecque fondamentale : l’image est soit eikon (l’icône), soit eidolon (idole), soit phantasma.
La triple distinction grecque : l’image comme eikon, eidolon et phantasma
L’image comme icône (eikon) : la présence de l’absent
Le premier sens de l’image est l’icône : il s’agit là, tout simplement, de ce qui ressemble à quelque chose. L’image eikon est ainsi le tableau réaliste, la sculpture, ou encore la gravure : elle serait donc, à première vue, l’imitation fidèle du modèle.
Mais en approfondissant la distinction entre l’image et son modèle, l’on arrive à un premier problème. Certes, l’image a toujours un objet, et vise donc toujours à figurer un modèle : or, comment savoir qu’elle le fait de manière appropriée ? Si la question peut alors se poser en art, elle est aussi importante en science : le modèle scientifique est bien l’image de la nature, mais inversement, ce n’est que par un modèle que l’on peut connaître la nature qu’il nous reste à observer.
On peut par exemple songer à la physique théorique, qui exige d’imager mathématiquement des dimensions inexplorables par la technique (l’infiniment petit) : c’est alors une correction permanente de ces images qui s’impose au scientifique au fil des découvertes qui contredisent la validité de l’image préalablement proposée, comme le montre l’exemple du modèle atomique de Bohr. Le problème est donc de savoir comment l’on peut juger de la véracité d’une image alors même qu’elle figure quelque chose d’absent : car soit l’on se réfère alors au modèle, mais alors l’image perd de sa valeur, soit l’on accepte qu’elle dénature toujours le réel – mais alors la question de la nécessité-même de l’image se pose.
L’on peut alors défendre, face à cette dévalorisation de l’image, l’exigence de son désintéressement. Ainsi Kant, se positionnant contre une approche conceptuelle de l’image artistique dans sa Critique de la faculté de juger, préferera le plaisir esthétique ressenti face à une image artistique à son intérêt rationnel. Mais le danger des icônes, comme le montre la querelle des iconoclastes, se pose lorsque le spectateur confond l’image et son modèle sans considérer le rapport de médiation – et donc la distance – entre les deux : l’on parle alors d’une image-idole, ou eidolon.
Les dangers de l’image : l’image-idole (eidolon) ou créatrice de fantasmes (phantasma)
Si l’image est dangereuse, c’est ainsi parce qu’elle peut se faire idole : les Grecs font ainsi la différence entre l’eidos (l’idée) et l’eidolon, cette image non savante, avec laquelle l’on entretient alors un rapport non pas de connaissance, mais de jugement non avéré. Autrement dit, l’image, parce qu’elle renvoie toujours à ce qu’elle ne montre pas assez, en tant que l’on perd toujours quelque chose du figuré en figurant, est créatrice de fausses croyances, et pire, de croyances qu’on pense réelles : d’idoles.
De là suit une longue tradition de penseurs condamnant soit l’image pour son caractère dangereux : Platon le premier, dans sa République, met en garde les éducateurs au sein de la cité contre les mythes – c’est-à-dire les images – véhiculées par les poètes. Au contraire, il faut, pour le philosophe grec, se détourner de l’eidolon pour chercher l’eidos, c’est-à-dire la connaissance vraie. Ainsi se trouve condamnée non plus seulement l’image, mais l’imagination : créatrice de fantasmes, déréalisatrice, elle plongerait l’individu dans un monde coupé du sien.
Le terme de phantasma renvoie ainsi à l’aspect dévalorisant, et par là dévalorisé, de l’image : elle est ce qui nous éloigne dangereusement du réel pour lui préférer la rêverie, à l’instar des poètes dans la cité platonicienne qu’il faudrait bannir. Le problème de l’image serait donc qu’elle se transforme irrémédiablement en idole, détournant la connaissance du vrai vers une ignorance du monde qui ne se sait même pas ignorante. La raison en est que l’image, par définition, représente, et donc présente, c’est-à-dire fige : dès lors, le mouvement du monde et du temps ne sauraient être rendus.
Le problème du mouvement : imager pour fixer le temps
Si donc le temps est, pour Platon, “l’image mobile de l’éternité“, c’est que l’image ne peut donc jamais nous présenter le réel, qui lui, existe nécessairement et éternellement sous une forme que nos yeux ne peuvent atteindre. Autrement dit, nous évoluons tous dans le temps : partant, soit l’image dénature le temps et ne nous montre donc pas le sensible – à savoir le monde dans lequel on évolue -, soit l’image de l’éternité, à savoir du réel par excellence, ne peut nous être donné par l’image, puisque celle-ci ne peut être véritablement mobile.
Le paradoxe de l’image est donc d’être toujours sensible et par là, intelligible pour nous, mais sans jamais pour autant nous montrer l‘intelligible qui lui (ou le nouménal chez Kant), est le seul réel qui vaille. Ainsi, l’image nous rappelle sans cesse notre condition sensible : elle ne désigne ainsi pas seulement la représentation artistique ou picturale, mais toute donation du monde pour nous, quelle qu’elle soit. L’image marque donc une frontière indépassable entre l’humain et le transcendant, ce qui explique que certaines religions, comme le calvinisme par exemple, refusent d’imager les objets de leurs foi.
Mais si des auteurs comme Kant postulent que tout ce qui se donne à nous se donne par image, c’est donc dire qu’il faudrait la dépasser, tout en la sachant indépassable. Or, si nous ne sommes justement que sensibles, ne doit-on pas redonner sa positivité à l’image pour la considérer dans toute sa puissance, non pas seulement évocatrice, mais aussi créatrice ?
L’image repensée comme correspondance : des nouveaux moyens de peindre le monde à la revendication du mouvement continu
De la photographie à la poésie : repenser l’image comme tremplin de médiations
C’est ainsi par une réflexion sur les manières contemporaines de créer des images que l’on peut lui redonner sa chance : la photographie fixe un réel advenu, et le cinéma, lui, transcende l’apparente immobilité de l’image pour nous livrer le mouvement. L’avènement de la photographie au XIXe siècle permet ainsi de repenser une image qui non pas seulement évoque, symbolise, mais montre : l’image est alors dévoilement, et non plus simple représentation ; elle présentifie et non simplement présente.
Pourtant, l’image photographique fige toujours le cours du temps : le problème est alors de savoir si l’on peut penser une représentation d’un objet par image qui permettrait de l’atteindre par médiation. Autrement dit, si l’image est médiation (et elle l’est par définition), ne peut-on pas penser cette médiation comme moyen d’atteindre son objet ?
Il faut alors se tourner vers l’image littéraire, celle d’un Proust ou d’un Baudelaire. Empreinte de correspondances, c’est-à-dire de renvois vers des signifiés pluriels, l’image entendue comme métaphore est celle qui permet non seulement de saisir le réel, mais d’en saisir plusieurs, au-delà de tout autre type de figuration possible. Imager ainsi, c’est-à-dire figurer par le style, c’est la fameuse figure de style : celle qui image autre chose que ce que le simple mot dénote, en créant de nouvelles significations à même le texte.
C’est là le sens et l’enjeu des Correspondances baudelairiennes, de la réminiscence proustienne, ou encore de ce que Reverdy nomme “une forte image, neuve pour l’esprit, [qui rapproche] sans comparaison deux réalités distantes dont l’esprit seul a saisi les rapports” . Mais les rapports entre deux réalités distinctes proposées par l’image ne doivent pas nécessairement se créer à-même l’esprit : ils peuvent, avec l’avènement du cinéma, exister à même l’image.
L’avènement du cinéma : le mouvement au centre de l’image
Si l’on se penche sur la spécificité de l’image cinématographique, l’on peut en effet repenser le problème de la représentation du mouvement par l’image. Celle-ci n’est plus seulement une figuration purement symbolique, ou même à l’origine de médiations que l’esprit devrait lui-même opérer, mais la forme même de la médiation : autrement dit, au cinéma, l’image elle-même contient ce mouvement qui semblait lui manquer, en tant qu’elle présente une réalité mobile. C’est ce que Deleuze nomme l’image-mouvement : une image composée elle-même de succession d’images, sur laquelle repose le dispositif cinématographique.
Le problème est alors de savoir si l’on peut réellement penser la succession au même titre que le mouvement, c’est-à-dire l’apparence du mouvement au même titre que sa réalité : quel est ce réel dont nous parle l’image cinématographique, et suffit-il de l’imiter pour l’égaler ? Il semble alors que même l’image cinématographique ne puisse rendre raison du réel. Si elle crée, certes, et nous parle donc en figurant, elle perd toujours la capacité à représenter autre chose qu’elle même : soit elle est la preuve d’une absence et d’une immatérialité, soit elle n’est transfiguration d’une réalité qui ne saurait se donner à la figuration. Il faut donc repenser la notion d’image à l’aune de la phénoménologie, qui la remet au centre de l’échiquier philosophique au XXe siècle.
Le renouveau de l’image par la phénoménologie
Il vous faudra en effet, cette année, vous intéresser aux auteurs tels que Merleau-Ponty, Heidegger ou encore Sartre, que l’on relie habituellement au courant de la phénoménologie. Ce dernier étudie tout particulièrement ce qu’on appelle le phénomène, à savoir ce qui se manifeste : le problème est alors de comprendre les conditions d’apparitions du phénomène. Autrement dit, il ne s’agit pas de savoir comment le monde se donne à voir et sous quelles modalités, mais comment il est possible que le monde se donne à voir – c’est-à-dire que son image existe.
Là intervient donc le concept clé d’image : il ne s’agit plus, contrairement aux Grecs, de se demander si l’image n’est qu’apparence, mais au contraire de considérer que si tout ne se donne que comme image, alors il faut bien concéder à l’apparence un statut de réalité.
Il n’y a donc plus de transfiguration lorsqu’il y a figuration, puisque cette figuration est la seule réalité possible : autrement dit, comme l’écrit Merleau-Ponty dans L’Oeil et l’esprit, l’image est un “visible à la deuxième puissance“, car elle décuple le monde en tant qu’il existe, et en tant qu’il nous est donné à exister. Vous devrez donc aussi bien, cette année, donner sa chance à l’image qu’à ses détracteurs : voici votre programme en Culture Générale 2025.