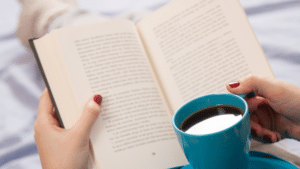A l’approche des dernières épreuves des concours, Major Prépa te propose un corrigé rédigé du sujet classique “Le pouvoir de la violence”.
Il te permettra ainsi de réviser tes références sur la violence politique, mais aussi celles sur la légitimité morale (ou non) de la violence, et enfin, celles qu’il ne faut pas oublier : les exemples artistiques*. Bonne lecture, et bon courage pour la dernière ligne droite !
NB : Nous avons ici choisi comme référence artistique l’oeuvre d’Ernaux, La Place, qui défend un contre-pouvoir face à la violence sous forme de témoignage, et non véritablement sous forme d’art (quoique cela se discute, puisque La Place reste une oeuvre d’art) ; mais il est également possible de choisir une oeuvre d’art qui dise le pouvoir de l’art face à la violence, voire d’interroger le pouvoir de la violence artistique. Comme pour tous les III, plusieurs options sont possibles : quoiqu’il en soit, nous vous encourageons vivement à ne pas oublier les exemples artistiques, qu’ils soient littéraires, picturaux ou cinématographiques, dans vos analyses.
Le pouvoir de la violence : introduction
Lorsqu’un animal réagit à une attaque à son égard par la violence, en tuant, par exemple, son prédateur, il oppose à la force de celui-ci celle de sa propre violence. Dans cette situation de lutte, comme en situation de guerre, il s’agit ainsi d’une opposition entre deux pouvoirs : le conflit n’aboutit que lorsque l’une des forces prévaut, c’est-à-dire lorsqu’elle est plus puissante. Or, ce choc des puissances est précisément ce qui caractérise la violence : l’on peut donc dire, peut-être, qu’elle se définit par son pouvoir.
Parler du pouvoir de la violence semble en effet aller de soi : en tant que la violence est une force exercée sur autrui (ou un objet) par contrainte, son exercice présuppose d’emblée un certain pouvoir, c’est-à-dire une certaine capacité à imposer quelque chose à autrui. Il n’y a pas de violence sans situation où elle se manifeste : “le pouvoir de la violence” serait donc non seulement ce qui la caractérise, mais peut-être même une tautologie.
Pourtant, il nous faut d’emblée distinguer ici le pouvoir de l’autorité. Si le pouvoir est de fait (un représentant est élu au pouvoir), l’autorité est de droit (le représentant est choisi légitimement) : or, si la violence a certes du pouvoir en tant qu’elle est une contrainte, c’est justement parce qu’elle est d’abord imposée à autrui qu’elle n’a a priori pas d’autorité. Ainsi, si l’animal use de la violence pour se défendre, n’est-ce pas qu’il ne maîtrise plus la situation, et n’a donc justement pas de pouvoir ?
“Le pouvoir de la violence” semble donc se nier lui-même : que la violence puisse imposer sa force implique qu’elle ait besoin de le faire ; or, si elle doit prouver sa valeur, c’est bien qu’elle n’a préalablement pas suffisamment de pouvoir. Pour autant, il est indéniable que la violence est elle-même une forme de pouvoir, en tant qu’elle est un moyen d’aboutir à ses fins, et donc d’étendre ses capacités. Dès lors, la force caractérisant la violence facilite-t-elle sa capacité à asseoir le pouvoir, ou n’est-elle pas au contraire toujours condamnée à se substituer à l’autorité ?
Nous verrons d’abord que “le pouvoir de la violence” existe par défaut, en tant que la violence est une force, et détient donc nécessairement la capacité de contraindre (I). Mais il nous faudra alors remarquer qu’un pouvoir sans autorité n’en est pas un : dès lors, “le pouvoir de la violence” semble insuffisant, tant l’exercice de la violence est finalement toujours la preuve d’une faiblesse initiale de son agent (II). L’on pourra alors comprendre que “le pouvoir de la violence” n’existe que si la violence “peut” effectivement non pas être exercée, mais avoir de la puissance, c’est-à-dire de la légitimité, ce qui non seulement permet son pouvoir, mais l’augmente. (III).
I. La violence, fondamentalement, est une contrainte : elle est donc par définition une forme de pouvoir.
Il nous faut d’abord remarquer que la violence est toujours une force s’appliquant à un objet, une personne ou une entité collective : elle est donc toujours, par définition, une forme de pouvoir.
En effet, “le pouvoir de la violence” désigne d’abord et avant tout ce que la violence peut : or, en tant qu’elle contraint, elle peut ce qu’elle veut, puisque sa seule existence suppose que sa victime la subisse. S’il n’est donc pas nécessaire d’avoir du pouvoir pour faire preuve de violence, le fait d’exercer une forme de violence signifie immédiatement que l’on a du pouvoir : c’est ainsi que Hobbes explique, au chapitre 13 du Léviathan, l’existence du pouvoir dans un “état de nature” dans lequel il n’y a pourtant pas d’Etat civil. En effet, dans un tel état fictif dans lequel la loi (et donc la punition) n’existent pas, la violence fait loi : puisqu’il n’y a pas de propriétés, mais seulement des possessions, chaque individu peut faire violence à l’autre impunément pour saisir son terrain afin de se nourrir. Il y a donc une forme de pouvoir qui n’est pas institutionnelle, mais qui existe pourtant de fait, puisque le simple acte de contraindre l’autre suffit à se placer en position de pouvoir.
Or, si l’on pense “le pouvoir de la violence” comme le seul rapport de contrainte imposée à autrui ou un objet, et que faire preuve de violence induit nécessairement le fait d’avoir du pouvoir, ne dit-on pas de la violence qu’elle est omnipotente ? Il ne s’agit en réalité pas de défendre que la violence donne nécessairement un plein pouvoir, mais de noter qu’elle donne un certain pouvoir, “le pouvoir de la violence” étant toujours conditionné, et par là potentiellement limité, par des facteurs extérieurs. C’est la raison pour laquelle Machiavel, dans Le Prince, enjoint le souverain à faire preuve de violence, certes, mais seulement lorsque celle-ci est nécessaire pour atteindre ses fins – la finalité du souverain devant toujours être, aux yeux de Machiavel, non pas de bien gouverner, mais de garder le pouvoir. Si donc le pouvoir du souverain est menacé, la violence est, pour Machiavel, légitime, justement parce qu’elle permet d’augmenter son pouvoir. “Le pouvoir de la violence” n’est donc pas indépendant du pouvoir de ceux qui l’exercent.
Pourtant, l’on peut tout de même penser un pouvoir total de la violence : mais il faut alors considérer que “le pouvoir de la violence” est non pas une simple force et une contrainte, mais une puissance. La puissance se distingue en effet du pouvoir en tant qu’elle n’a pas besoin de se manifester concrètement pour exister : autrement dit, le pouvoir doit s’exercer pour exister, tandis que la puissance existe sans nécessairement prendre la forme du pouvoir, puisqu’elle peut passer, par exemple, par le charisme, simple aura sans action concrète. “Le pouvoir de la violence”, sa force donc, vient ainsi aussi principalement non pas de ce qu’elle peut faire, mais de ce qu’elle pourrait faire : autrement dit, elle vient de son aspect menaçant, comme le montre Haneke dans la première partie de son film Funny Games. Le réalisateur retranscrit en effet ce “pouvoir de la violence” en montrant, par l’utilisation d’une très forte tension, qu’il n’est pas nécessaire à la violence de s’exprimer pour être effective, et encore moins efficace : les deux hommes s’introduisant dans la maison font en effet déjà preuve de violence lorsqu’elle n’est pas physique en paraissant menaçants, tout comme ils ont déjà le dessus sur la famille qu’ils séquestrent. “Le pouvoir de la violence” est donc également une puissance, et non seulement un exercice du pouvoir concret.
Mais si “le pouvoir de la violence” vient de son pouvoir potentiel, des effets qu’elle pourrait avoir, l’on peut tout aussi bien avancer que la violence n’a alors pas vraiment de pouvoir, puisqu’elle est exercée justement lorsque d’autres moyens ne sont pas disponibles.
II. La violence du pouvoir comme limite du pouvoir de la violence
Dans un deuxième moment, notre réflexion doit donc nous amener à questionner la réalité d’un “pouvoir de la violence”, alors même que toute violence s’exerce justement par volonté de contraindre, et donc d’imposer un pouvoir : or, s’il faut imposer son pouvoir, c’est bien qu’il nous manque de l’autorité.
Il faut en effet noter que “le pouvoir de la violence” est peut-être limité dès lors qu’il correspond non pas à la possibilité d’agir, mais au fait d’avoir de l’autorité. Que la violence s’exerce signifie en effet que la contrainte devient une nécessité : dès lors, celui qui l’exerce est lui-même contraint, et n’a donc véritablement de pouvoir. C’est pour cette raison que Rousseau remarque, au chap. III du Contrat social, que le pouvoir qu’a celui qui exerce la violence parce qu’il le peut, en vertu de la plus grande faiblesse de son ennemi, ne peut acquérir un réel droit, qui correspondrait au droit du plus fort : autrement dit, le droit du plus fort est non pas une forme de pouvoir, mais “un droit qui périt lorsque la force cesse“, c’est-à-dire un pouvoir temporaire. “Le pouvoir de la violence” n’est donc qu’apparent.
Ce faut pouvoir l’est d’autant plus qu’à user de la contrainte, l’on force l’autre non pas à obéir, mais à se soumettre. Autrement dit, “le pouvoir de la violence” n’a en réalité pas de légitimité : il existe de fait, mais n’est pas accepté, et n’est donc pas une autorité. L’on peut ainsi prendre l’exemple du chap. X du Contrat social, dans lequel Rousseau analyse le cas du pouvoir tyrannique, qui se définit par une indifférence vis-à-vis des lois au profit de la violence : alors que la justice est par définition légitime, acceptée par le peuple et sa volonté générale, celui qui gouverne par la violence, au contraire, ne régit pas la cité en fonction d’une telle volonté : ce que les citoyens subissent est hors de leur portée, et ne peut donc pas être justifié par leur volonté. La violence du pouvoir est donc ce qui limite le pouvoir de la violence.
Si donc la volonté générale peut limiter le pouvoir de la violence en tant qu’il en refuse l’autorité, celui-ci ne peut donc jamais trouver à s’exprimer complètement. Le processus de limitation du pouvoir de la violence est ainsi bâti et justifié par plusieurs sphères qui permettent de faire société : la justice d’abord, évidemment, mais aussi la morale, et, en somme, ce qui permet de faire civilisation. Le pouvoir de la violence est donc forcé d’être amoindri dès que celui qui souhaite faire preuve de violence vit en société : mais cela signifie qu’il existe toujours une certaine forme de violence cachée, pouvant potentiellement s’exprimer, et créant donc ce que Freud nomme dans l’ouvrage éponyme un “malaise dans la civilisation“. S’interrogeant sur la légitimité du précepte chrétien selon lequel il faut “aimer son prochain”, Freud avance en effet qu’il existe pourtant, au sein de tout un chacun une “agressivité” fondamentale, naturelle et pulsionnelle, l’impératif chrétien venant donc s’opposer à la raison : autrement dit, l’on ne peut espérer de l’Homme qu’il vive en société sans faire preuve d’égoïsme, à moins de bâtir une civilisation, c’est-à-dire une forme de vivre-ensemble qui empêche cette pulsion primordiale de l’exprimer, et la relègue au rang de l’inconscient.
“Le pouvoir de la violence” serait donc caché, tu, et par là amoindri, voire inexistant : pourtant, il existe bel et bien, concrètement, et ce qu’il soit moral, psycholigue, symbolique, au sein de nos sociétés. Ainsi, n’est-ce pas justement parce qu’il est insidieux qu’il est le plus efficace ?
III. “Le pouvoir de la violence” est d’autant plus grand que cette violence est insidieuse, et regagne par là sa légitimité, en tant qu’elle est acceptée inconsciemment
Notre troisième moment devra donc se demander si l’on ne peut pas repenser un véritable pouvoir de la violence malgré la volonté, consciente ou non, de le brider : s’il faut certes limiter les effets de la violence, et par là son exercice, “le pouvoir de la violence” ne peut-il pas au contraire s’adapter à ces contraintes pour s’exprimer autrement, et qui plus est, devenir plus puissant de par son existence inconsciente et insidieuse ?
Notre réflexion nous a en effet mené à voir que si “le pouvoir de la violence” manque d’autorité, il peut néanmoins, comme vu en première partie, s’exprimer en tant que puissance. L’on peut donc penser que si “le pouvoir de la violence” est brimé, là où la civilisation, c’est-à-dire les moeurs, la justice, empêchent à la violence de s’exercer sans punition, la violence peut et doit néanmoins trouver de l’autorité ailleurs que dans cette seule expression effective : autrement dit, la violence, pour avoir du pouvoir, ne doit plus être un simple acte, ne doit plus s’exercer réellement, physiquement, mais prendre la forme d’une menace. C’est une telle menace omniprésente que Weber entend dénoncer dans Le Savant et le Politique : en effet, si l’Etat détient la possibilité de faire preuve d’une “violence physique légitime” dont il a le “monopole“, c’est parce qu’en tant qu’il forme l’organe gouvernant et organisant la cité, il s’octroie le droit de décider lui-même du droit à utiliser la violence, ou non. Autrement dit, l’Etat est ce qui légitime la violence : dès lors, la violence peut bien faire autorité, là où elle compte sur l’autorité de l’Etat pour exister. L’on peut illustrer cet exemple par un évènement concret : si la police peut faire preuve de violence, et ne pas être punie pour cela, c’est parce qu’elle est un organe de l’Etat : dès lors, “les forces de l’ordre” sont jugées légitimes à user de la force pour maintenir l’ordre, c’est-à-dire l’absence de troubles au sein de la cité. Or, si la violence utilisée par la police est justifiée par l’Etat, elle est loin d’être justifiable, c’est-à-dire justifiée moralement : mais parce qu’elle repose sur l’autorité de l’Etat, son pouvoir peut difficilement être limité. L’on voit donc que lorsque “le pouvoir de la violence” est légitimé par une instance doté d’autorité – et par là, peut être, autoritaire – il est non seulement efficace et effectif, parce qu’il repose justement sur une autorité sous-jacente qui le justifie, mais également d’autant plus difficile à contrer, puisqu’il est légitimé, et par là justifié, alors même qu’il n’est pas justifiable.
C’est donc dire que pour limiter le pouvoir de la violence”, qui peut venir s’opposer au droit ou même à l’intégrité des individus qui subissent cette violence, c’est bien l’origine de cette légitimité du pouvoir de la violence qu’il faut questionner, voire combattre. Or, l’acte même de légitimer le pouvoir de la violence peut être si insidieux qu’il n’est même plus remarqué : ainsi, “le pouvoir de la violence” est d’autant plus fort que l’on oublie qu’il n’est pas justifié. L’on peut ici prendre l’exemple des violences systémiques, qu’on nomme ainsi parce qu’elles fonctionnent à l’échelle collective de manière insidieuse : le sexisme, le racisme, l’homophobie, sont autant d’exemples de discriminations, et donc de violences, dont le fonctionnement, et donc parfois l’existence, est inconscient, puisqu’elles participent à structurer un système auquel les individus appartiennent, mais par cette appartenance, subissent aussi bien ces discriminations qu’ils apprennent à vivre avec toute leur vie, par exemple par l’éducation genrée. L’exemple du classisme, repris par Annie Ernaux dans La Place, illustre bien cet exercice insidieux et d’autant plus efficace du “pouvoir de la violence” : en effet, dans ce roman autobiographique, l’autrice, narrant la vie de sa famille de classe ouvrière, relate ainsi l’entrée de son père dans une corderie à l’âge de treize ans : “Naturellement, pas d’autre choix que l’usine”. Si son père n’avait “pas d’autre choix”, c’est bien qu’il y était contraint : mais il ne s’agissait pas d’une violence physique, tangible, mais d’une nécessité qui paraissait “naturelle”, car imposée à leur classe sociale. Si “le pouvoir de la violence” doit gagner en autorité et en légitimité pour s’accroître, voire pour simplement exister comme nous l’avons vu, et que la violence a la possibilité d’asseoir son pouvoir par la légitimation d’une instance tierce, alors l’on comprend que ce “pouvoir de la violence” ait intérêt à se loger là où on ne le voit pas, et où son autorité peut donc être d’autant plus forte.
Il faut donc se demander comment ce “pouvoir de la violence” peut être combattu, voire aboli, alors même qu’il s’exprime insidieusement. Cela signifie en effet qu’il faut d’abord saisir que la violence a lieu : il faut donc pouvoir la dire. C’est justement l’entreprise défendue par Ernaux dans l’ouvrage sus-cité : mettre des mots sur cette violence, par la littérature. Mais de manière surprenante, Ernaux ne défend pas l’idée d’un pouvoir supérieur de l’art, qui pourrait subvertir le pouvoir de la violence en lui opposant une force supérieure : au contraire, il s’agit pour elle de retranscrire l’exacte manière dont parlaient ses parents, par un style sobre, qu’elle juge même “plat”. Or, c’est justement par “ces mots et ces phrases” sobres, dénuées de lyrisme, et par là objectives car non esthétisés, qu’elle peut “dire les limites et la couleur du monde où vécut [s]on père, où [elle] vécut aussi” : le choix esthétique d’Ernaux est ainsi de retranscrire le langage utilisé par ses parents, et non d’embellir – et donc de fausser – son monde, au profit d’une démarche artistique. Ainsi, “le pouvoir de la violence” se dit et se décèle par le témoignage et la retranscription précise de ses effets sur le monde. Il ne s’agit donc pas d’opposer la violence au “pouvoir de la violence”, mais le langage et la raison, pour redonner à ceux et celles qui subissent ce pouvoir la possibilité de le dire, le pouvoir de le faire : au pouvoir de contraindre, propre à la violence, s’oppose ainsi, finalement, la liberté de le dire.*
Conclusion
Nous nous étions demandé si “le pouvoir de la violence” venait de la force que constituait la violence, ou s’il ne devait pas d’autant plus assouvir son autorité et sa puissance qu’il était nécessaire : si en effet la violence, en tant qu’elle contraint par définition, a donc toujours du pouvoir, elle n’est pourtant douée d’autorité qu’à condition d’être légitime, c’est-à-dire légitimée. Si donc “le pouvoir de la violence” est d’autant plus grand qu’il est légitimé par celles et ceux qui le subissent, c’est en décelant, en décrivant et surtout en disant et en comprenant sa mécanique que l’on regagne de la liberté face à un “pouvoir” désormais exhibé, et par là remis en cause.