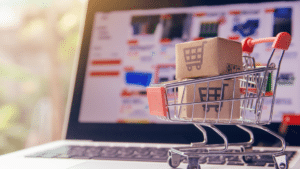Dans le champ du management des ressources humaines, de nombreuses théories ont émergé pour comprendre ce qui motive les individus au travail et comment les organisations peuvent adapter leur management pour en tirer le meilleur. Qu’il s’agisse de besoins physiologiques, d’équité, de récompenses ou d’autonomie, les théories RH permettent d’éclairer les pratiques des entreprises et d’envisager des stratégies adaptées. Voici un panorama complet des grandes théories à connaître.
La pyramide des besoins de Maslow (1943)
La pyramide d’Abraham Maslow est probablement la plus connue des théories de la motivation. Elle repose sur l’idée que les individus cherchent à satisfaire une série de besoins hiérarchisés.
Maslow identifie cinq niveaux de besoins
- Besoins physiologiques : liés à la survie (se nourrir, se loger, dormir).
- Besoins de sécurité : sécurité de l’emploi, stabilité financière, protection contre les dangers.
- Besoins sociaux : appartenance à un groupe, relations affectives, intégration sociale.
- Besoins d’estime : reconnaissance, statut, respect des autres.
- Besoins de réalisation de soi : épanouissement personnel, accomplissement des objectifs personnels et professionnels.
Application managériale
Selon Maslow, un individu ne peut s’intéresser aux besoins supérieurs que lorsque les besoins inférieurs sont satisfaits. En management, cette théorie invite à :
- assurer de bonnes conditions de travail (locaux agréables, salaire correct) ;
- garantir la sécurité de l’emploi et de bonnes perspectives ;
- favoriser l’esprit d’équipe et les relations interpersonnelles ;
- reconnaître les efforts et les réussites ;
- offrir des possibilités d’évolution et de développement personnel.
Limites
Cette hiérarchisation est parfois critiquée, car les besoins peuvent être perçus différemment selon les individus, les cultures et les contextes.
La théorie bifactorielle de Herzberg (1959)
Frederick Herzberg propose une approche originale de la motivation en distinguant deux types de facteurs qui influencent la satisfaction au travail :
- Les facteurs d’hygiène : ce sont des éléments extrinsèques au travail (conditions de travail, salaire, relations hiérarchiques, sécurité de l’emploi). Leur absence génère de l’insatisfaction, mais leur présence ne suffit pas à motiver durablement.
- Les facteurs de motivation : ce sont des éléments intrinsèques liés au contenu même du travail (responsabilisation, reconnaissance, accomplissement personnel, intérêt des missions). Leur présence motive réellement et durablement.
Application managériale
Pour Herzberg, améliorer uniquement les conditions matérielles et organisationnelles n’a qu’un effet limité. Il est nécessaire d’enrichir le travail, de proposer des responsabilités et de reconnaître les résultats.
Exemples :
- Donner de l’autonomie dans les missions.
- Mettre en place des systèmes de reconnaissance.
- Proposer des projets valorisants.
Limites
Comme Maslow, Herzberg est critiqué pour son caractère parfois trop universel, alors que les attentes des salariés peuvent être très diverses.
La théorie X et Y de McGregor (1960)
Douglas McGregor, dans The Human Side of Enterprise, identifie deux conceptions opposées du management :
- Théorie X : les individus sont paresseux, n’aiment pas travailler et cherchent à en faire le moins possible. Il faut donc les contrôler, les sanctionner et les diriger strictement.
- Théorie Y : les individus aiment travailler s’ils y trouvent un intérêt et les bonnes conditions. Ils cherchent à se responsabiliser et à s’impliquer s’ils sont bien encadrés.
Application managériale
Cette théorie souligne que la conception qu’un dirigeant se fait de ses collaborateurs conditionne son style de management :
- Une entreprise qui fonctionne selon la théorie X mettra en place un contrôle strict et peu de participation.
- Une entreprise qui adopte la théorie Y privilégiera un management participatif, l’autonomie, la créativité et la reconnaissance.
Exemples :
- Google ou Decathlon favorisent la théorie Y en responsabilisant les équipes et en valorisant l’autonomie.
- Certains secteurs très normés (industrie lourde, sécurité) adoptent des principes proches de la théorie X pour des raisons de sécurité ou de productivité.
La théorie des attentes de Vroom (1964)
Victor Vroom développe une approche cognitive de la motivation, basée sur la rationalité des individus. Selon lui, la motivation dépend de trois éléments :
- L’expectation : la probabilité perçue par un individu d’atteindre un certain niveau de performance en fournissant un effort donné.
- L’instrumentalité : la croyance selon laquelle cette performance permettra d’obtenir une récompense.
- La valence : la valeur qu’accorde l’individu à cette récompense.
Application managériale
Pour être efficace, le management doit jouer sur ces trois dimensions :
- S’assurer que les objectifs sont atteignables.
- Garantir que la réussite sera récompensée (prime, promotion, reconnaissance).
- Adapter les récompenses aux attentes des individus (certains valorisent l’argent, d’autres la reconnaissance, ou encore la flexibilité).
Exemple :
Dans une entreprise commerciale, si un commercial n’est pas convaincu que ses efforts lui permettront d’atteindre des objectifs réalistes (expectation), ou que la prime promise ne sera pas versée (instrumentalité), ou qu’elle n’a pas d’intérêt pour lui (valence), sa motivation restera faible.
La théorie de l’équité d’Adams (1963)
John Stacey Adams propose une théorie basée sur la perception de l’équité dans les relations sociales au travail. Les individus comparent leur situation à celle des autres en évaluant :
- leurs apports (inputs) : temps de travail, compétences, efforts, ancienneté ;
- leurs résultats (outcomes) : salaire, avantages, reconnaissance, évolution.
Ils comparent ce ratio à celui de leurs collègues. Si une iniquité est perçue, elle peut provoquer démotivation, absentéisme, baisse de performance ou démission.
Application managériale
Un bon management doit veiller à :
- assurer une politique de rémunération et de reconnaissance juste et transparente ;
- communiquer sur les critères d’évolution ;
- éviter les différences de traitement injustifiées.
Exemple :
Dans une entreprise où deux salariés ayant les mêmes responsabilités reçoivent des primes très différentes sans justification, celui qui se sent lésé peut perdre sa motivation ou quitter l’entreprise.
Conclusion
Ces cinq grandes théories constituent un socle essentiel pour comprendre les comportements au travail et les leviers d’action managériale. Elles permettent d’expliquer pourquoi certains dispositifs fonctionnent dans une entreprise et pas dans une autre. Lors de votre épreuve de management et sur le dossier RH, elles sont importantes et doivent être mobilisées. La RH est souvent négligée, car jugée trop facile, c’est donc un bon moyen de te démarquer et de gagner des points précieux !
Et pour en savoir plus sur les auteurs incontournables en management, lis cet article !