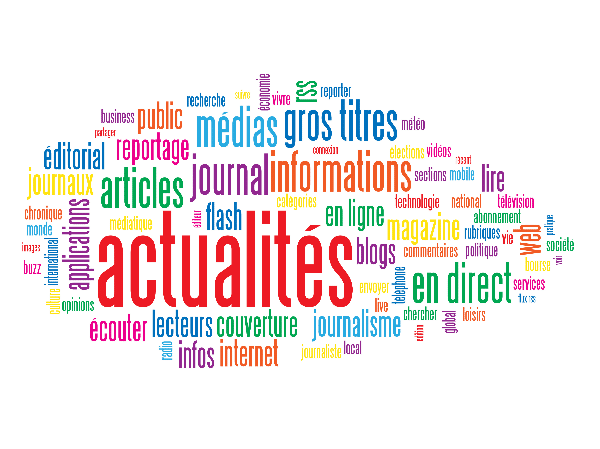Dans cet article, on reprend les faits marquants de l’actualité de cette fin d’année 2024 !
Élections américaines
Le mois de novembre a été tout particulièrement marqué par l’élection présidentielle américaine qui a vu le retour de Donald Trump au pouvoir. Celle-ci s’inscrit dans un contexte de dépenses électorales sans précédent, atteignant 15,9 milliards de dollars, reflétant l’enjeu mondial et économique.
Les priorités économiques de Trump
Tout d’abord, Donald Trump prévoit une hausse des droits de douane, qui s’élève à 10 % sur toutes les importations et même à 60 % sur celles en provenance de Chine. Cette stratégie vise à réduire le déficit commercial américain, exacerbé par une dépendance croissante aux importations européennes et chinoises, qui ont dépassé 84,4 milliards de dollars en septembre 2023. Trump accuse ces régions de « réindustrialisation prédatrice », cherchant à capter les parts de marché américaines par le biais d’exportations compétitives.
De plus, sur le plan fiscal, Trump propose une baisse drastique des impôts sur les sociétés (de 21 % à 15 %) et un allègement de la réglementation bancaire. Ces mesures visent à stimuler l’investissement domestique, mais risquent de creuser encore davantage le déficit public, estimé à 10 500 milliards de dollars sur dix ans, selon Goldman Sachs.
Impacts économiques internationaux
Les politiques protectionnistes de Trump affecteront directement l’Union européenne (UE) et la Chine. Pour l’UE, les barrières douanières entraîneraient une baisse de 1 % du PIB d’ici trois ans, avec une chute encore plus marquée en Allemagne. La Chine, quant à elle, pourrait intensifier ses exportations vers d’autres marchés, ce qui pourrait provoquer une cascade de mesures protectionnistes dans le monde entier. Ces tensions renforceraient une guerre commerciale mondiale, exacerbant les défis économiques globaux.
En parallèle, les subventions massives prévues par les États-Unis, notamment dans le cadre de l’Inflation Reduction Act (IRA), accentuent le risque de délocalisations vers les États-Unis, fragilisant les industries stratégiques en Europe.
Réactions des marchés
Les marchés financiers ont également été affectés par cette élection. En effet, l’indice VIX, indicateur de la nervosité des investisseurs, a bondi de 16 %, témoignant d’une forte incertitude préélectorale. Cependant, l’action de Tesla a grimpé de 14 %, profitant directement des perspectives de soutien réglementaire et fiscal pour les entreprises américaines innovantes.
Néanmoins, la politique budgétaire expansionniste de Trump pourrait aggraver l’inflation, défi majeur pour la Réserve fédérale (Fed). Si l’inflation s’accélérait, la Fed pourrait limiter ses baisses de taux, freinant la croissance économique. Les principaux créanciers des États-Unis, la Chine et le Japon, réduisent déjà leurs portefeuilles de bons du Trésor, signalant des inquiétudes croissantes quant à la soutenabilité de la dette américaine.
Le cas Musk
À la suite de son élection, Donald Trump s’est empressé de nommer Elon Musk à la tête du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE). Ce dernier doit réduire les dépenses fédérales de 2 000 milliards de dollars d’ici le 4 juillet 2026, et ce, en réduisant les programmes sociaux, la Défense et la bureaucratie, visant ainsi des économies massives de 30 %.
Toutefois, grand nombre de personnes se posent des questions quant aux intérêts personnels de Musk. En effet, la privatisation de certains services publics pour réduire les coûts risque de profiter à ses sociétés, tout en atténuant les nombreuses enquêtes qui les ciblent. Par exemple, SpaceX est visée pour discrimination et violations environnementales, tandis que Tesla est sous surveillance réglementaire. Dans tous les cas, ce poste a déjà boosté la fortune personnelle de Musk : la valeur de Tesla a grimpé de 25 % après l’élection, ajoutant 50 milliards de dollars à sa richesse.
Bitcoin
Le Bitcoin (BTC) atteint des niveaux proches de son record historique, avoisinant les 100 000 dollars, en étant porté notamment par les élections américaines. En effet, la victoire de Trump a renforcé les perspectives d’une réglementation crypto-friendly.
Ainsi, sa promesse de destituer Gary Gensler, président hostile aux cryptos de la SEC, et de transformer les États-Unis en « capitale mondiale de la crypto », a déclenché une entrée nette de deux milliards de dollars dans les ETF Bitcoin en une semaine. La nomination d’Elon Musk au sein du gouvernement et le soutien massif d’un Congrès pro-crypto (219 élus favorables) consolident cet optimisme.
COP29
La COP29, tenue en Azerbaïdjan durant deux semaines, a abouti à un nouvel accord visant à tripler le financement climatique des pays du Nord vers ceux du Sud, atteignant 300 milliards de dollars par an d’ici 2035. Bien qu’en augmentation par rapport aux 100 milliards annuels promis pour 2020-2025, cela reste tout de même loin des 1 000 milliards réclamés par les pays en développement, et encore plus des 2 300 milliards jugés nécessaires, selon les économistes.
Un des points marquants est la réforme du marché des crédits carbone sous l’article 6 de l’Accord de Paris. Ce dispositif, censé orienter des milliards vers des projets climatiques, permet alors aux pays riches d’acheter des crédits pour atteindre leurs objectifs, en alliant un aspect économique et environnemental. Toutefois, cette mesure suscite des critiques, notamment sur le suivi des contributions et la comptabilisation ambiguë entre prêts et subventions de crédits.
De plus, la COP29 a également encouragé la participation d’acteurs privés, de banques de développement et de pays comme la Chine, les États du Golfe, ou Singapour (bien que Pékin refuse toute obligation formelle). Le financement climatique repose donc largement sur des contributions volontaires. Cependant, alors que 1 000 milliards d’investissements privés sont jugés nécessaires, chaque dollar public attire en moyenne seulement 22 centimes de fonds privés, selon le think tank ODI.
Ainsi, l’accord est insuffisant face à l’urgence climatique. Les ONG et les pays du Sud dénoncent un effort budgétaire limité (7 % de la croissance économique mondiale) et un manque d’ambition. Il faudra attendre la COP30 au Brésil pour espérer voir des actions concrètes pour limiter le réchauffement à 1,5 °C.
Sommet G20
Le sommet du G20 tenu au Brésil a été marqué par des tensions autour de l’accord de libre-échange UE-Mercosur. Celui-ci vise à supprimer des taxes pour stimuler les échanges entre l’Europe et les pays d’Amérique latine, et pourrait générer 40 à 45 milliards d’euros annuels pour l’UE. Toutefois, les agriculteurs français s’y opposent fermement, dénonçant une concurrence déloyale due aux normes sanitaires et environnementales moins strictes des produits sud-américains, notamment la viande bovine brésilienne.
Les syndicats agricoles, inquiets pour la souveraineté alimentaire européenne après une année de récoltes désastreuses, prévoient des blocages majeurs en parallèle du sommet. Dans un même temps, Emmanuel Macron, initialement favorable au traité, a exigé des « clauses miroir » intégrant des normes environnementales plus strictes, citant les risques de déforestation au Brésil. Cependant, la France se retrouve seule dans sa défense, alors que des pays comme l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie soutiennent l’accord pour booster leurs économies, notamment grâce aux exportations automobiles et à l’accès aux ressources du Mercosur.
Clique ici pour plus d’articles !